La guerre est bien finie, cette fois, il faut tourner la page… mais comment ?
La nouvelle est arrivée un matin de printemps avec le facteur : le village d’en face avait commandé un monument et attention, pas n’importe quel monument. Un poilu conquérant, haut de deux mètres et courant vers la victoire fusil à la main, tout juste s’il ne souriait pas, l’imbécile ; et à ses pieds, dix noms gravés sur le socle, les dix noms de ceux qui avaient leur tombe au pays. Parfois avec un cercueil vide, d’accord, mais au moins le télégramme officiel était arrivé, mort au champ d’honneur, mort pour la France, pension pour la veuve et enfants pupilles de la Nation. Et ceux de leurs hommes qui étaient rentrés assisteraient à l’inauguration en héros, avec médailles, couronnes de fleurs, petit compliment des élèves de l’école, discours du maire – la rumeur bruissait de la venue du préfet, de l’évêque et même d’un général. Pour un peu, on aurait cru qu’ils avaient gagné la guerre à eux tout seuls.
À Nardeillac, pas de cercueils, pas de cérémonie, pas de préfet ; pas même de médaille. Pourtant, les gars avaient bien fait leur devoir, eux aussi, et la victoire, c’était autant la leur ! Des maisons sans homme, un village peuplé de vieux et d’enfants, la tristesse et le manque, ça devait bien valoir quelque chose, non ? Au moins la reconnaissance du pays ? Seulement, quoi faire : ériger une stèle au sacrifice des absents, c’était dire tout haut que c’était fini, qu’on abandonnait tout espoir. Et puis, une inauguration pour des ni morts ni vivants, en présence de deux anciens combattants dont l’un était fêlé et l’autre même pas d’ici, ça frisait le ridicule. Que dirait celui qui, enfin de retour, lirait son nom calligraphié sur du marbre, comme une épitaphe ? Parce que certains n’en démordaient pas : ça prendrait le temps que ça prendrait, mais d’autres allaient revenir.
Au marché, chez le boulanger et au café, dans les rues et le dimanche après la messe, les discussions s’enflammaient. Le vieux Joseph, surtout, à qui il manquait deux fils et un gendre, ne décolérait pas : pas revenus, ça voulait dire pas morts ! Il fallait quand même des preuves pour affirmer que des gars de 20 ans s’évaporaient dans la nature sans laisser de traces ! Les discussions des familles resurgissaient en miniature jusque dans la cour de l’école, entre pleurs et bagarres. Le maire essayait avec douceur de calmer les optimistes : l’armistice, la victoire, ça commençait à faire un bail, il s’agissait d’être raisonnable, on savait maintenant que beaucoup de cadavres étaient restés dans la boue des champs de bataille et quand on retrouvait des corps, car on en trouverait encore longtemps, ils n’étaient pas toujours identifiables. C’était une tragédie, mais il fallait, à présent, l’accepter pour continuer à vivre. Le curé, pour une fois du côté de la République, le soutenait comme il pouvait, vite renvoyé à son bon Dieu dont on se demandait bien ce qu’il avait foutu ces dernières années. Mais au fond, ni la République ni l’Église n’avaient envie de graver ces noms dans la pierre, comme si ce faux tombeau devait enterrer les disparus dans les limbes.
Il fallait bien admettre que les soldats ne rentraient pas toujours en bon ordre, chacun connaissait des exemples de démobilisations sans aucune logique, on savait aussi que des prisonniers revenaient parfois alors que tous les pensaient perdus. Anatole, parti dans les premiers jours, était rentré dès la fin de la guerre. Victor avait suivi quelque temps plus tard, venant on ne savait trop d’où, mais bien vivant et en un seul morceau, avant Madeleine, l’infirmière qui les avait soignés tous les deux et avait choisi de s’installer au village – pour le calme de la campagne après la violence et le sang, disait-elle, et on faisait semblant de la croire ; mais c’était un secret de polichinelle qu’elle avait plutôt suivi jusqu’ici les doux yeux noirs de Victor. Et Madeleine, elle était bien trop fatiguée du chagrin et de la douleur pour avoir le cœur d’ôter l’espoir à ceux qui y croyaient encore. Alors, elle avait raconté de belles histoires, toutes vraies, d’ailleurs : des histoires merveilleuses de miraculés de la chirurgie, d’hommes portés disparus finalement retrouvés sains et saufs, d’amnésiques qui se réveillaient un beau jour avec tous leurs souvenirs en tête. Mais elle avait gardé pour elle les tragédies, les jeunes gens qui se laissaient mourir de désespoir, les gazés qui étouffaient peu à peu, les défigurés qui refusaient de retourner dans leur famille : quel mal y avait-il à laisser les gens rêver ? Après tout, on ne pouvait jamais jurer de rien, dans la vie.
On en était là, à surveiller l’air de rien ceux d’en face, grâce au facteur qui racontait comme sans y penser les progrès du monument, le sculpteur et ses ambitions de Michel-Ange, la fierté des habitants, la querelle, tout de même, à propos de l’emplacement : à l’église, à la mairie, devant l’école ? Instituteur, maire et curé rejouaient la Révolution et se disputaient les morts. On moquait ces voisins et leurs prétentions, mais l’idée faisait son chemin, tout doucement, d’avoir ici aussi quelque chose, on ne savait pas trop quoi, pour ne pas oublier ces noms qui, un jour, allaient finir par s’effacer des mémoires. Chacun ruminait son chagrin et ses espoirs, sans trouver comment s’en dépêtrer.
Heureusement, le facteur apportait parfois de quoi se remonter le moral, comme ce petit événement qui allégea un peu l’atmosphère : à la prochaine foire, en ville, il y aurait un cinématographe. La main sur le cœur, les gamins juraient déjà une obéissance éternelle si on les y emmenait. La foire, c’était l’occasion d’avoir des nouvelles de tout le pays, de renouveler les garde-robes, de s’offrir quelques colifichets et de rapporter aux enfants une ou deux bricoles, de s’accorder de menus plaisirs, en somme, et c’était déjà bien. Mais le cinématographe, c’était la promesse de rire, de s’émerveiller, de s’étonner en regardant des gens s’agiter à l’autre bout du monde comme s’ils étaient à quelques mètres, des ministres barbus en redingote sauter d’un fiacre ou d’une automobile devant l’Assemblée, des élégantes déambuler dans les rues de Paris ! Bref, on allait voir le monde.
Ça, pour voir du pays, on en a vu. D’un bout à l’autre de la planète. Le Jardin des Plantes, ses grandes serres et sa ménagerie, des gens de toutes les couleurs, des paquebots prenant la mer, des compétitions sportives… et des monuments sur tous les continents. D’abord, une cérémonie d’inauguration : veuves en grand deuil, orphelins au visage trop sérieux, officiels avec écharpe tricolore, rescapés en uniforme avec leurs médailles devant un soldat de pierre. Puis, des monuments dans tous les coins de France et de Navarre, en marbre, en granit, gravés, sculptés, guerriers avec des hommes en armes, émouvants avec des enfants et leur mère en pleurs, et même, à peine croyable, une sorte d’obélisque pour la paix universelle qui avait fait scandale. C’était comme si tout le pays, comme si le monde entier s’était transformé en cimetière ; ça donnait à réfléchir.
On a donc réfléchi. Chez ceux d’en face, la République l’avait doublement emporté (le curé n’en dormait plus, disait-on en riant) : la statue, avec sa liste de sacrifiés, serait érigée devant la mairie, pendant qu’à l’école, sous le préau, il y aurait une plaque avec les noms gravés en lettres d’or, surmontés de l’inscription « À nos enfants morts pour la Patrie », dorée elle aussi. Ça en faisait, des dorures, pour quelque chose de si triste ; mais c’est peut-être de ce scintillement que jaillit enfin l’illumination. On ne sait trop comment, on ne sait trop de qui surgit l’idée, comme une évidence, de ce qu’il fallait faire à Nardeillac : on allait inscrire les noms de ceux qui étaient partis, ceux des deux qui étaient rentrés et puis, tant qu’à faire, celui de Madeleine qui les avait ramenés presque sains et saufs ; mais on n’allait écrire ni « Morts pour la France » ni « Disparus » ni rien du tout. Il n’y aurait que des noms, de la place pour l’espoir et quelques petits oiseaux bleus, ces petits Stridula volansis qu’Anatole avait découverts là-haut dans la brume, au-dessus de la boue et du désespoir, et qui avaient, on y croyait dur comme fer, protégé tous les hommes de Nardeillac.
Le jour de l’inauguration, on n’a vu ni préfet ni évêque et encore moins de général. Sur la place entre la mairie et l’église, un grand bloc de pierre claire était désormais dressé, sur lequel étaient simplement gravés des noms et une ribambelle d’oiseaux ; le maire a prononcé quelques mots, les écoliers ont chanté et déposé des fleurs. Puis, comme si cette cérémonie marquait enfin un retour à la normale, un point final à la guerre, la der des ders, c’était sûr, la petite foule s’est mise à discuter de choses et d’autres, des récoltes à venir, de l’été qui approchait et du bal de la Saint-Jean. Dans le soir tombant d’une douce journée de printemps, les enfants couraient, insouciants ; ils avaient la vie devant eux, croyaient-ils.
Quinze ans de paix tout au plus, mais heureusement, ils ne le savaient pas.
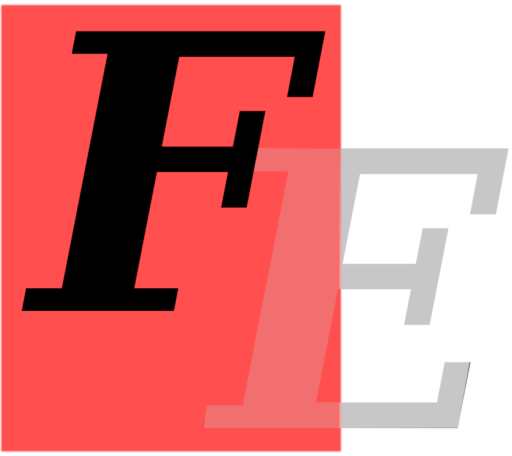

Laisser un commentaire