Après une fouille archéologique de la cave j’ai retrouvé, encore brillante sous sa pochette en papier cristal, la photo de ma classe de terminale. Sous les grands marronniers, dans la cour du vieux lycée en briques démoli depuis, une petite trentaine d’adolescents gauches et fanfarons prennent la pose autour de leur professeur préféré, pipe au bec et costume de velours côtelé – avec pièces de cuir aux coudes, naturellement.
Une habile manœuvre au succès inespéré m’a placé à côté de Sonia Deberre, de ses cheveux blonds et de ses yeux bleus, en plein milieu de la photo. J’ai un sourire de pur bonheur qui m’a valu des semaines de vannes que j’ai encaissées sans rien dire : j’étais en photo avec Sonia Deberre, la fille qui m’encombrait le cerveau vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et le reste n’avait pas d’importance.
Autour de nous je reconnais pratiquement tous les autres. Sybille Lagallay, une première de la classe, caricature de petite fille modèle. Barnabé Dhenry, chétif et transparent, qui n’ouvrait jamais la bouche. Éric, dont les parents – complaisants ou totalement irresponsables, le mystère n’avait jamais été vraiment élucidé – nous laissaient régulièrement organiser des soirées monstres dans leur immense appartement au bar toujours plein. Et Hervé, bien sûr.
Je n’avais pas eu de nouvelles depuis sept ans, jusqu’à ce mail, son de clochette dans la nuit, cause de mon insomnie et de l’exploration nocturne des profondeurs de la maison : il organisait un dîner pour nos quinze ans de bac. Avec lui, j’avais tout partagé : les billes, les virées à vélo puis à mobylette, les bobards servis aux parents, les paquets de clopes et les bières piquées dans le frigo familial. Notre amitié avait duré vingt ans, même les filles ne nous avaient pas séparés. Je me suis planté devant le grand miroir de l’entrée, ma photo sous le bras. J’étais ridicule.
Je suis allé me coucher pour me relever vers cinq heures, au beau milieu d’un cauchemar dans lequel Hervé me poursuivait, une cravate à la main, en répétant « t’as besoin d’un vrai boulot, mon vieux, d’une vie sociale ! », pendant qu’une Sonia de dix-sept ans s’approchait de moi en souriant, avant de se cacher le visage dans les mains et d’éclater en sanglots. Il faisait déjà très chaud, et j’ai mis sans trop y croire mes mauvais rêves sur le compte de la canicule.
J’ai pris une douche, fait du café, ouvert un paquet de cigarettes et je me suis installé dans le jardin avec mon ordinateur dans l’idée de me mettre au travail pour ne plus penser au reste. Mais j’étais trop furieux pour me concentrer. Depuis des années j’étais seul, tranquille, minable, d’accord, mais j’étais le seul à le savoir ; et voilà qu’un emmerdeur dont j’avais réussi à oublier jusqu’à l’existence venait tout gâcher.
Je me sentais agressé, comme si le monde entier, ou du moins ma classe de terminale, s’était ligué contre moi. Arnaud Berletti, l’espoir littéraire du lycée qui se prenait pour un poète à dix-huit ans et avait frôlé la gloire à vingt-cinq ; ils avaient tous dû attendre, pendant quelques années, de voir mon nom dans les vitrines des librairies. Et voilà qu’ils allaient enfin pouvoir me poser LA question : « Eh ben ? Qu’est-ce que t’es devenu ? On cherche ton nom, tu sais, à chaque rentrée littéraire, t’as un pseudo ou quoi ? » Je pourrais alors lire dans leur regard le plaisir coupable et sournois que procure l’échec des autres ou, pire encore, la déception apitoyée et la sollicitude.
À force de torturer délicatement mon ego en imaginant divers scénarios aussi humiliants que raffinés, je me suis endormi. À mon réveil, j’avais un nouveau mail d’Hervé. Il me signalait que l’événement était relayé sur le site ancienspotes.fr et me proposait de m’héberger, puisque la soirée avait lieu à Paris. En un instant j’ai eu la vision glaçante d’un week-end interminable avec un copain que je ne connaissais plus, sa femme (forcément adorable) et ses enfants (magnifiques, bien sûr) qui me regarderaient avec une pitié discrète comme le raté que j’étais ; non merci. Puis, brusquement, ma colère est tombée, et j’ai rendu les armes. Je n’avais pas rêvé de Sonia depuis qu’elle était partie, je l’avais effacée de mon esprit, enlevée des photos sur les murs et tout à coup elle était là, j’entendais son rire, j’entendais la voix d’Hervé qui m’évoquait la sienne. J’avais désespérément envie de la voir une dernière fois, de la toucher ; j’étais aussi malheureux que le jour où j’avais compris qu’elle ne reviendrait pas. Et tant pis si, de honte, je devais ensuite me terrer chez moi et ne plus jamais en sortir.
J’ai eu tout à coup envie d’expliquer à quelqu’un pourquoi je me contentais maintenant de traduire, et sous un pseudonyme encore, les œuvres des autres. Envie de raconter l’histoire banale et pourtant vraie de la page qui restait blanche depuis que Sonia avait disparu de ma vie. De me justifier, de dire que ce n’était pas ma faute si j’avais déclaré forfait. De retrouver le groupe d’autrefois, même ceux que je n’aimais pas, pour me replonger dans ce que nous étions et revenir pendant quelques heures quinze ans en arrière. Je m’étais promis de ne pas le faire, mais je suis allé sur ancienspotes et je les ai tous cherchés.
Puis j’ai appelé Hervé. Sa voix n’avait pas changé depuis la dernière fois, sept ans auparavant, quand il m’avait téléphoné pour m’annoncer qu’elle était partie. Sonia l’avait chargé de le faire et de me remettre une lettre dans laquelle elle expliquait tout. Et moi, comme l’imbécile prétentieux et jaloux que j’étais alors, que j’étais toujours, je lui avais raccroché au nez. C’était bien une fille qui nous avait séparés, finalement ; mais c’était moi le coupable. Il m’avait envoyé la lettre, que dans un accès de colère j’avais balancée dans un coin sans l’ouvrir. Je n’avais plus jamais adressé la parole à mon meilleur ami, et je n’avais plus jamais écrit une ligne. J’étais parti vivre à la campagne et je n’avais plus revu personne.
Après les politesses d’usage, un peu hésitantes, après un bref instant de gêne, je lui ai demandé de but en blanc s’il l’avait lue, cette lettre. Il n’en avait pas eu besoin, me dit-il, Sonia l’avait écrite devant lui. Il n’arrivait pas à croire que je ne l’avais pas lue. « Quel con, dit-il doucement. Quel gâchis. » L’amour de ma vie était parti parce que j’étais devenu insupportable d’égocentrisme, avec mon prix littéraire et mes prétentions au génie. Mais comme le Petit Poucet, elle avait laissé des cailloux blancs derrière elle, des rendez-vous au fil des années, comme autant de secondes chances que j’avais ratées comme j’avais raté le reste.
La fameuse lettre contenait sept feuilles, sept possibilités de retrouvailles, de reconquête. Ce dîner pour les quinze ans du bac était la dernière, la seule pour laquelle Hervé était autorisé à m’appeler directement. Ma dernière chance. J’ai voulu savoir s’il avait revu Sonia, si elle m’attendait vraiment. Mais il n’a rien voulu me dire. J’allais raccrocher quand je lui ai demandé : « Et toi, au fait, raconte, qu’est-ce que tu fais maintenant ? Tu es marié, des gamins ? » Il a eu un petit rire triste et m’a répondu : « Tu n’as jamais rien compris, hein ? C’était toi qu’elle aimait, je n’y pouvais rien. Et tu l’aimais aussi, vous étiez heureux, c’est la vie. Allez, à samedi. » Je n’avais rien compris, en effet. Quel imbécile.
Quand je suis arrivé à Paris, il tombait une petite pluie fine, tenace. De la terrasse vitrée du café d’autrefois, en face du bâtiment futuriste construit sur les ruines de l’ancienne bâtisse de briques rouges, j’ai regardé longtemps des lycéens qui sortaient de cours en riant, les cheveux dans les yeux et le jean traînant par terre. L’inévitable téléphone et une clope à la main, ils vivaient intensément, et pourtant sans en avoir conscience, cette époque merveilleuse, exaltante et dérisoire où l’on est tellement sûr, parce que l’on est tout neuf, de vivre dans un monde nouveau.
J’étais à leur place il y a quinze ans ; j’y retourne ce soir. Je suis aussi ému à l’idée de revoir Sonia aujourd’hui que je l’étais le jour de la photo de classe quand je me suis glissé à côté d’elle. J’ai marché longtemps pour ne pas être en avance – comme autrefois : surtout ne jamais arriver le premier à une soirée, le comble de la ringardise.
Devant le restaurant, pour me donner une contenance, je sors un bloc et un stylo et je commence à répondre à la lettre que je n’ai jamais lue. Je ne sais pas par où commencer. Une main légère se pose sur la mienne. Il n’y aura pas de dîner d’anciens pour nous ce soir, mais merci, Hervé : nous allons l’écrire, cette lettre. Une lettre de retrouvailles.
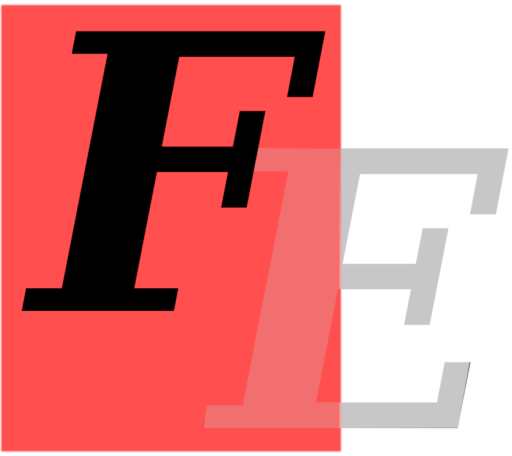

Laisser un commentaire