Pour me fondre dans la masse, j’avais tout prévu : jean, tee-shirt gris et sweat de la même couleur, des Stan Smith, un sac US avec deux ou trois noms de groupes tracés au marqueur. Pas de marque originale, rien d’excentrique : j’étais prêt pour ce nouveau lycée. Un bahut énorme, à l’ancienne, qui allait de la sixième à la terminale. L’idéal pour passer inaperçu. L’idéal pour moi, quoi. Personne ne m’y connaissait, je n’y connaissais personne et je n’avais pas vraiment l’intention de remplir mon carnet d’adresses, c’était parfait.
La solitude ne m’a jamais fait peur et j’ai toujours préféré les conversations à deux ou trois aux grosses fiestas. Mais depuis Anaïs, c’est devenu ma principale aspiration, presque une obsession : peser le moins possible dans l’univers. Enfin, le strict minimum vital, histoire de pas trop faire flipper les parents et de ne pas attirer l’attention des profs, ni en bien ni en mal. Être dans la moyenne, quoi. Comme si devenir un point immobile et minuscule dans le monde devait me garantir sinon la sécurité, au moins une certaine forme d’anesthésie.
Car le monde est un endroit dangereux et cruel. Où les innocents sont punis et les coupables en liberté. Où la tragédie se sent partout chez elle. On m’a parlé de malchance, de coup du sort. De la vie qui continue, de travail de deuil, de l’avenir devant moi. Mais personne n’a su répondre à la seule vraie question : pourquoi elle ? Pourquoi la vie prend-elle la peine de créer un être si merveilleux pour le bousiller ? On m’a répondu génétique, hasard et probabilités.
Anaïs n’était rien de tout ça, elle avait 16 ans, une passion pour les fringues des années 60, de longs cheveux bouclés blond foncé attachés n’importe comment dans un chignon en équilibre qui ne tombait jamais et de grands yeux clairs toujours prêts à rire. 16 ans, ce n’est rien et pourtant ce sont déjà quelques milliers de jours et de rêves et l’accumulation de milliers de souvenirs.
Elle lisait des romans policiers sanglants et des poèmes de la Renaissance, étudiait trois langues pour devenir traductrice, mais se serait bien vue aussi faire un peu de cinéma, « pour voir comment c’est » ; ou bien guide touristique, « pour bouger un peu » ; ou gardienne de musée, « pour voyager sans bouger en regardant les touristes ».
Elle aurait probablement fait tout ça et même plus, si la nature n’avait pas inventé de faire s’arrêter le cœur des jeunes filles, pour rien, tout d’un coup, sans prévenir : « On ne pouvait pas savoir et de toute façon, tu n’aurais rien pu faire. » Comme si ça rendait la chose moins insupportable.
Les premières semaines, je me reprenais chaque matin son absence en pleine figure. C’était douloureux à en devenir fou, mais je cultivais cette douleur, je ne voulais pas l’oublier, m’habituer. Je voulais que ma vie soit mêlée à la sienne, pour toujours. Ma mère n’en dormait plus et tenait à « faire quelque chose », elle avait peur que je me foute en l’air, mon père se faisait engueuler et traiter d’inconscient quand il essayait de la persuader que le temps me calmerait.
J’avais arrêté d’aller au lycée après avoir pété les plombs en plein cours, face à une prof qui me manifestait devant toute la classe sa sollicitude condescendante – incroyable, le nombre de gens persuadés de savoir « ce qui vous fera du bien ». Alors qu’on n’a pas du tout envie ni d’aller bien ni de se laisser distraire de son chagrin. Je m’étais mis à hurler et je crois qu’elle avait eu vraiment peur de moi. Je crois que tout le monde a eu un peu peur de moi, ce jour-là. Aujourd’hui, je pense qu’elle était sincèrement persuadée de bien faire ; mais je ne lui avais rien demandé.
Après ça, mon frangin m’a dit : « Écoute, personne ne peut comprendre réellement ce que tu ressens. Mais ce n’est pas une raison pour tout flinguer autour de toi. Les parents n’en peuvent plus et maman va complètement craquer si tu continues. Alors, puisque tu es vivant, agis comme un vivant, au moins pour ceux qui t’entourent. Et achète-toi un punching-ball pour passer tes nerfs. »
Mon frère le philosophe, toujours dans le vrai. Et le punching-ball, c’était vraiment une bonne idée. J’ai appris à séparer ma tristesse de la vie courante ; j’ai recommencé à voir quelques potes (eux, au moins, n’auraient jamais eu l’idée de me parler d’Anaïs sans que j’aborde moi-même le sujet) ; j’ai vu mes parents retrouver l’espoir, puis la certitude que leur fils aurait une vie. Je ne les ai pas détrompés.
À force de jouer à ce petit jeu, j’ai repris une existence qu’on peut qualifier de normale : inscription dans un nouveau bahut, retour aux repas de famille, discussions sur l’avenir avec ma mère — qui continuait à me surveiller, je le sentais. Je lui en voulais un peu, mais c’était son boulot et elle me connaissait trop bien, même si ça me fait mal de l’admettre. Heureux de ce retour au calme, mon père lui faisait confiance : tant qu’elle avait l’air de trouver que j’allais de mieux en mieux, il était content et ne cherchait pas plus loin.
Mon frère, lui, n’était pas dupe, mais c’était un adepte de la discipline intérieure : d’après lui, si on s’entraîne tous les jours à fond pour le rôle qu’on estime être le sien, on finit par y entrer. Il avait raison, ce petit con.
Mon rôle, donc, consiste à vivre, mais pas trop ; à ne pas laisser d’empreinte sur les gens, à exister un peu comme en lévitation dans ce monde : pas de traces, pas de manque, pas de chagrin. J’ai occupé mon temps, ces derniers mois, à apprendre à me concentrer : arts martiaux, musique, punching-ball. Tout le monde est soulagé de me retrouver « comme avant », même si, naturellement, « tout ça l’a quand même changé ».
Comme d’habitude, mon frangin a bien cerné le truc : « Tu crois que tu maîtrises tout, que cette histoire de faire son deuil, c’est des conneries d’adultes, et que la reprise de ta vie normale, c’est parce que tu veux bien donner le change. Eux, ils pensent que le travail de deuil se fait et que tu vas mieux (quoi que ça veuille dire, aller mieux). Bref, tout le monde est content, surtout moi, parce que je commençais à fatiguer, entre eux et toi. » Je l’ai traité de petit abruti prétentieux, mais il s’en fout, il sait qu’il n’a pas tort…
Et donc, ce matin, rentrée. Tranquille dans mon costume d’élève ordinaire, certain d’être anonyme (dix classes de terminale, je devrais avoir la paix). Les premières heures se sont passées sans heurt, l’appel, le prof qui se présente ; le déjeuner, un self pas terrible, mais il y a pire. Pas de cours l’après-midi, on commence vraiment seulement la semaine prochaine. Je respire, je vais rentrer chez moi comme je suis venu, glissant entre mes univers sans que personne m’ait remarqué plus que nécessaire.
C’est alors que je l’ai vue, plantée au milieu du couloir. Une masse de cheveux blond foncé tout frisés, des yeux bleus étirés vers les tempes dans un visage étroit, elle chantonnait tout bas en retournant la cassette dans son walkman. Ça courait partout autour d’elle, mais elle ne remarquait rien, tout entière dans sa chanson elle battait le rythme de son pied. Elle a levé les yeux et croisé les miens, elle a souri : « Oh, pardon, c’est bien moi, ça, à tous les coups là où il ne faut pas. » Et elle a continué paisiblement à bricoler sa cassette dont la bande s’était à moitié entortillée.
J’ai retenu une réponse débile du genre « non non, pas du tout, c’est moi qui… ». Le temps qu’elle finisse de réparer les dégâts, le couloir s’était vidé et j’étais toujours là, en train de la regarder, elle s’est marrée et elle a dit : « Moi, c’est Alice, je débarque de l’autre bout du pays, tu m’as bien l’air d’arriver de nulle part, toi aussi. Tu connais un troquet décent dans le coin ? Ma première conversation de la journée, ça se fête. »
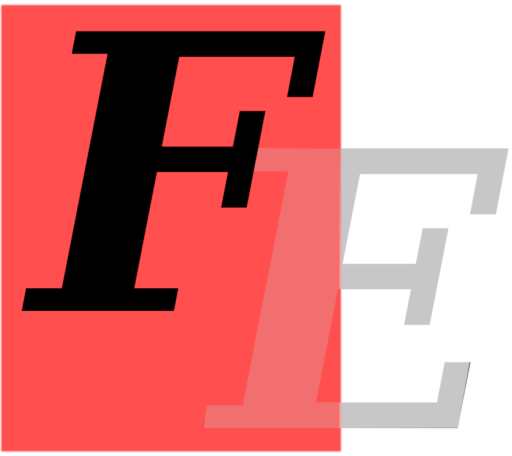

Laisser un commentaire