“Croyez-vous aux fantômes, jeune fille ?” Jeune fille est un peu exagéré, mais bon. L’expression fait partie des droits acquis de la vieillesse. Et celui qui s’adresse à moi fêtera bientôt ses quatre-vingts ans.
J’ai retrouvé mon auteur préféré, disparu depuis plusieurs années. S’il était mort, je me serais fait une raison. Mais il avait déserté. Pour moi qui dévorais depuis des années ses biographies d’écrivains, le sevrage était par trop brutal. Je lisais Octave d’Albret avec autant de bonheur que les écrivains qu’il me recommandait sans le savoir. Il me liait d’amitié avec eux et par là même avec lui.
Et voilà qu’un jour il quittait le navire, sans une pensée pour ceux qu’il laissait derrière lui. J’ai longtemps rongé mon frein, puis j’ai décidé d’agir : chacun a un rôle à jouer sur cette terre et où irait-on si tout le monde faisait comme lui ?
J’ai commencé par m’introduire chez son éditeur. Oh, pas par la grande porte. Non, je me suis débrouillée pour être embauchée dans l’équipe d’entretien. Sous couverture, en somme. Au début, les autres me regardaient de travers : qu’est-ce qu’une fille comme moi – elles avaient appris, je ne sais comment, que j’étais traductrice – venait faire là ? Puis elles ont compris que je ne vivais que pour ces heures aux Éditions A.
Elles ne saisissaient pas bien mon enthousiasme, préférant de loin les modernes open spaces : donner un coup de chiffon, vider les corbeilles, passer la serpillière ne demandait guère de concentration, on pouvait penser à autre chose et il n’y avait pas grand risque d’esquinter la décoration. Il est vrai que le parquet ciré, les tapis, les plantes, les bouquins empilés par terre et les tableaux qui couvraient les murs donnaient plus de boulot. Ma passion de midinette pour Octave d’Albret avait achevé de les persuader que j’étais légèrement dérangée ; ce qui, ajouté au fait que je ne refusais jamais d’arranger une collègue côté horaires, a fini par les convaincre que j’étais bizarre, mais inoffensive.
Un soir, sur le bureau du fondateur de la maison, j’ai remarqué à côté du téléphone (filaire), un vieux Rolodex : à l’ère du smartphone, le doyen des lieux cultivait les accessoires rétro. J’ai lentement fait tourner le cylindre, déroulant le bottin littéraire des cent cinquante dernières années, jusqu’à trouver mon idole. J’ai noté l’adresse et le téléphone, tout remis en ordre, fini de passer l’aspirateur et démissionné le lendemain.
Quarante-huit heures plus tard, j’avais cassé ma tirelire et j’étais en route vers un village en bord de Loire dont je n’avais jusqu’alors jamais entendu parler.
Octave d’Albret avait trouvé refuge dans le seul coin de cette région dépourvu du moindre château et par conséquent du moindre touriste. Enfant du pays revenu en fils prodigue, il avait arrangé pour les vignerons locaux les rencontres avec les bons clients, traiteurs chics et restaurants confidentiels, assurant ainsi une discrète prospérité aux habitants. Ces derniers lui garantissaient en échange l’anonymat, même si les lycéens du coin obtenaient au bac de français des résultats qui épataient chaque année jusqu’au ministère.
J’ai loué une petite maison, repris mes traductions et je me suis doucement coulée dans la vie du village. Où, tout naturellement, j’ai croisé le chemin du grand homme.
Maudite époque. On ne peut jamais vraiment disparaître. J’avais pourtant pris toutes les précautions possibles : aucune existence numérique en dehors de mes publications, un exil-retour aux sources dans mon village natal où la discrétion est une vertu cardinale, une vie qui s’écoulait paisiblement entre ma bibliothèque, mon jardin et le Café de la Mairie.
On m’avait averti de l’arrivée d’une nouvelle habitante, ce n’est pas si grand, ici. Partagé entre la méfiance et la curiosité, je m’étais renseigné : une traductrice qui travaillait chez elle, apparemment une femme seule et discrète, je ne m’en étais pas inquiété.
Et maintenant, cette femme venait me déranger dans ma douce retraite. Elle s’est présentée au café, un de mes livres dans les mains, m’assurant qu’elle ne voulait pas troubler mon repos, mais seulement me dire que j’étais celui qui lui avait ouvert les portes de la lecture. Bon. Au moins, elle ne voulait ni dédicace ni autographe.
***
Elle habite l’ancienne maison du garde-barrière, le long de la voie ferrée aujourd’hui envahie de fleurs au printemps et de mûres en été. (Quand j’étais gosse, on guettait, l’oreille collée au rail comme dans les westerns, le train d’Orléans, tremblant de se faire surprendre et ramener à la maison par la peau du dos. Il y a longtemps que le train ne passe plus par ici.) Peu à peu elle n’a plus été qu’une habitante parmi d’autres, bavardant avec le boulanger et souriant aux enfants. Et un jour, tout naturellement, nous avons fait connaissance en bonne et due forme, oubliant l’incident du café.
Nous avons parlé de son travail de traduction, elle m’a raconté avec humour l’ennui sans fond des manuels techniques et autres modes d’emploi, elle qui rêvait des grands auteurs. Bientôt, nous avons pris l’habitude de nous retrouver au café, d’abord pour un thé l’après-midi puis de temps en temps pour déjeuner et enfin, de plus en plus souvent, pour boire un verre le soir.
Elle savait bien sûr qui j’étais, mais ne m’en parlait pas et respectait mon intimité, même si nos conversations littéraires ne me laissaient aucun doute sur le fait qu’elle connaissait tous mes livres. J’ai baissé ma garde et je l’ai invitée chez moi.
Nous avons passé des soirées entières à évoquer nos romanciers favoris et elle a fini par me dire qu’elle avait lu “passionnément” tous mes écrits. Le “passionnément” s’est logé dans un coin de mon cerveau et bien que rien n’ait changé entre nous, j’ai fini par appeler A., mon vieil éditeur et ami, pour lui demander si elle avait fait partie des gens qui m’écrivaient du temps de ma gloire.
En consultant mon courrier, A. n’a pas tardé à retrouver les lettres qu’elle m’avait envoyées au fil des années, d’abord élogieuses, traçant en creux le portrait d’une lectrice à l’esprit aiguisé. D’attristées lorsque je m’étais retiré du monde, elles s’étaient peu à peu chargées de colère et de reproches. Pas de quoi alerter la police, mais quand A., au détour d’une conversation avec l’une des femmes de ménage, a découvert qu’une traductrice avait brièvement fait partie de leur équipe, il m’a conseillé de faire attention.
Pour la première fois de ma vie, je me sens à ma place : je partage mes lectures avec Octave d’Albret. Mieux, nous sommes devenus amis. Je suis sûre que je finirai par le convaincre de se remettre au travail : nous sommes d’accord sur tout, comme des âmes sœurs, comme des esprits frères ! Nos conversations vont le stimuler, lui redonner le goût d’écrire. J’attends encore un peu avant de lui en parler ; quand l’occasion se présentera, je suis certaine qu’il viendra de lui-même à cette idée !
***
J’ai péché par impatience. Un soir, emportée par mon enthousiasme et un excellent cognac, je lui ai dit qu’il devait reprendre la plume, qu’il n’avait pas le droit de s’arrêter, qu’il ne s’appartenait pas, qu’il était un guide pour les lecteurs. À la façon dont il m’a regardée, j’ai su, quand il a dit non, que j’avais perdu la partie, qu’il ne me considérerait plus comme son alter ego, qu’il me verrait comme une groupie certes sincère, mais embarrassante. J’avais gâché mon unique chance de le convaincre.
***
Tout aurait pu en rester là. J’aurais pu rentrer chez moi et porter le deuil de mon idole. J’aurais déménagé, cherché ailleurs une petite place pour m’installer dans ma petite vie. Mais il est venu me voir le lendemain. Il a su que j’avais travaillé chez son éditeur, que je lui avais écrit ces lettres de reproches. Il ne m’en voulait pas ; il ne reviendrait pas sur sa décision, mais il pensait me devoir une explication, puisque après tout nous étions amis, n’est-ce pas ? Je l’ai donc écouté.
“Croyez-vous aux fantômes, jeune fille ? À présent que je suis presque un fantôme moi-même, j’estime avoir droit au silence…” Il avait rangé sa machine à écrire quand ses sujets d’étude s’étaient soudain matérialisés. Romanciers, poètes et philosophes surgissaient d’outre-tombe sans crier gare tandis qu’il écrivait sur eux. Et tous le harcelaient : “Pourquoi écrivez-vous sur moi ? De quel droit ? Que savez-vous de moi, de ma vie, des raisons qui m’ont poussé à mettre une virgule ici, un personnage là ? Qui êtes-vous pour oser lire ma correspondance, prétendre comprendre mes chagrins et mes joies ?” Il n’en dormait plus.
Son médecin l’avait rassuré : “Monsieur d’Albret, vous êtes solide comme un chêne : votre inconscient cherche à vous dire quelque chose, écoutez-le.” À cause de cet imbécile, Octave s’était “écouté” et avait compris, me dit-il, qu’il avait reculé toute sa vie le moment d’écrire et qu’à présent il était trop tard. Qu’il s’était fait biographe par simple et banale trouille et qu’en se penchant sur le travail des autres (surtout quand ces autres étaient morts), il s’était offert la meilleure des cachettes, mais qu’il avait, au fond, gâché son talent.
En quelques phrases, il avait renié son travail ; que faisait-il de ses lecteurs ? Je me suis ressaisie : “Octave, je n’avais pas imaginé à quel point ce travail avait pu vous dévorer, encore moins qu’il vous avait empêché de devenir vous-même l’un de ces écrivains que nous aimons tous les deux. Je ne vous en parlerai plus, nous continuerons nos conversations en oubliant cette soirée, d’accord ?” Nous nous sommes séparés contents l’un de l’autre ; demain, nous prendrons le thé chez moi.
Je suis content d’avoir enfin dit à quelqu’un ce que j’avais sur le cœur. Je n’avais jamais partagé mes fantômes avec personne, pas même avec A., mon complice de toujours. Elle a très bien compris pourquoi j’avais tout arrêté – qui à part elle, si fine lectrice, pour comprendre mes regrets d’écrivain manqué ? J’ai vu dans ses yeux qu’elle aussi parlait aux fantômes, que tous ces auteurs étaient comme des voisins pour elle. Je suis heureux finalement de n’avoir pas perdu son amitié, je suis un vieil homme et chaque minute compte. Je le lui redirai demain, devant une tasse de thé, en mangeant de ce délicieux moelleux au chocolat qu’elle réussit si bien.
Bien sûr que je crois aux fantômes. En réalité, faire apparaître leur fantôme est la meilleure façon de converser avec les écrivains, je le sais, et Octave, véritable écrivain, allait faire un excellent fantôme.
Le thé est prêt, le moelleux à ma façon aussi.
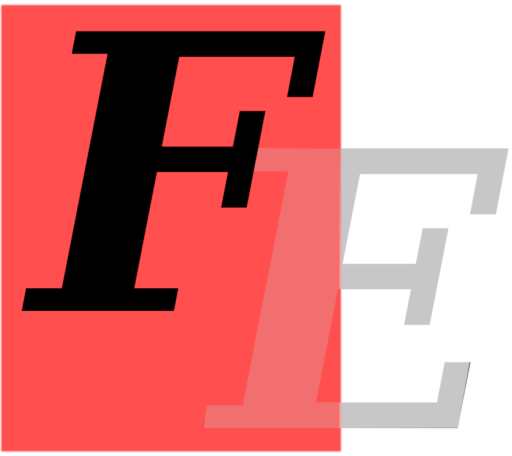

Laisser un commentaire