Mon frère avait 9 ans quand je suis né. Avec lui, j’ai appris à écouter les oiseaux en forêt, à pêcher, à reconnaître les champignons et les baies comestibles, à nager, aussi, dans la petite rivière toujours glacée où brillaient de petits cailloux dorés, comme un trésor de pirates. Dès que j’ai su marcher, il m’a traîné partout avec lui. Il m’expliquait le monde autour de nous et me montrait, dans un livre qu’il avait reçu comme prix d’excellence à l’école, les continents lointains et les paysages qui le faisaient rêver. « Un jour, j’irai là, me disait-il en regardant une carte ou une autre, enfin, j’irai partout et toi, mon vieux, tu me rejoindras. » J’adorais qu’il m’appelle « mon vieux ».
Nos parents travaillaient tout le temps : la journée entre les champs et les bêtes et le soir à la maison, en surveillant nos devoirs. C’était leur grande ambition, de nous voir quitter la terre, devenir instituteurs, pourquoi pas professeurs ou même employés de bureau, en tout cas autre chose que ce métier de paysan qui leur cassait le dos tous les jours de l’année. La guerre n’était pas si loin derrière nous et c’était sûr, plus jamais ça : la jeunesse remuait, les temps changeaient et ils se disaient que l’avenir n’était plus dans les villages.
Certains voisins ricanaient : à quoi ça rimait de vouloir envoyer ses gosses en ville quand on avait une terre fertile à transmettre ? Qui nourrirait le pays si tout le monde avait tout à coup la folie des grandeurs ? L’instituteur, lui, était content : nous deux, au moins, valions la peine qu’il se donnait pour faire entrer un peu d’instruction dans la cinquantaine de petites têtes qui ne pensaient qu’à la prochaine récréation ou au travail qui les attendait, le soir, à la ferme. Bon, le calcul était utile, d’accord, malgré les ridicules problèmes de baignoires qui fuyaient et d’horaires de trains qui se croisaient, et il fallait aussi savoir écrire proprement et sans fautes, on n’était pas des sauvages. Mais le reste, franchement, c’était bon pour les maîtres d’école, les gens des administrations ou les employés des Postes.
Moi, j’adorais la ferme. Je n’osais rien dire, mais je préférais les vaches et le potager aux leçons de géographie. J’aimais bien apprendre, pourtant, et mon frère, mon modèle, qui était premier partout, savait m’intéresser aux leçons de choses autant qu’à l’histoire et même aux leçons de morale – qu’il avait l’art de déclamer avec une ironie que je n’ai mesurée que bien plus tard. J’aimais bien apprendre, mais pour le plaisir, pas pour aller m’asseoir un jour derrière un bureau dans une ville enfumée ; j’avais besoin de la forêt et du chant des oiseaux pour être heureux.
L’année de son brevet supérieur, mon frère est parti en pension chez une tante qui habitait en ville. Il revenait aux vacances et reprenait avec moi les longues promenades en forêt, me racontait les merveilles citadines, « tu verrais ça, mon vieux ! », ses rêves de partir plus loin encore voir le monde. Moi, ce que j’entendais, c’était que notre monde, celui où nous étions nés, lui et moi, n’était plus le sien. Et je comprenais, même si je préférais ne pas y penser, que la vie allait nous séparer.
Pour fêter son brevet et l’encourager à continuer – ses résultats permettaient d’espérer une bourse –, nos parents lui offrirent une boussole. Aux anges, il m’expliqua que c’était là le premier élément de son équipement de globe-trotter et emporta l’objet dans toutes nos explorations. J’étais moins emballé : un autre diplôme signifiait son départ pour une ville encore plus lointaine, vers un univers qui me serait toujours plus étranger. Je ne pouvais plus faire semblant d’ignorer qu’il allait partir, un jour, pour ne plus revenir que de temps en temps, peut-être, en coup de vent. Et ses « mon vieux » affectueux me donnaient envie de pleurer.
Il fut reçu à tous ses examens, jusqu’à devenir ingénieur. Quant à moi, mon père avait compris très vite que ma vocation était à la ferme et nulle part ailleurs. « Mais rien ne force le cultivateur, disait-il à ma mère pour la consoler, à demeurer un ignorant ! On peut labourer en récitant des poèmes et l’avenir de l’agriculture est à la science. » Elle faisait mine de le croire et soupirait discrètement tandis qu’il se replongeait dans L’Agriculture nouvelle.
Le temps a passé, mon frère est resté en ville, mais contrairement à mes craintes, il revenait chaque été. Dès son arrivée, et bien que j’aie grandi, moi aussi, on reprenait la tradition : il sortait solennellement la boussole du tiroir où elle l’attendait sagement (je n’avais pas le droit d’y toucher) et m’entraînait crapahuter dans les environs comme si nous partions à la découverte d’une terre inconnue.
Je m’étais accommodé de ses absences, j’apprenais désormais à m’occuper de la ferme avec nos parents qui se trouvaient bien contents, finalement, d’avoir un enfant sur deux à l’âme paysanne. Souvent, j’ouvrais le tiroir et je contemplais cet instrument qui me fascinait en pensant à nos prochaines retrouvailles.
Et puis, à la fin d’un été qui avait pourtant ressemblé à tous les autres, il m’avoua qu’il ne reviendrait pas, en tout cas, pas l’année suivante. Il travaillait, à présent, il entamait « sérieusement, mon vieux, enfin ! » sa carrière d’ingénieur et allait collaborer à la construction de ponts je ne sais où, je ne l’écoutais plus, tout ce que j’avais entendu c’était qu’il serait loin. Il ne pouvait pas vraiment m’expliquer, c’était quelque chose qu’il devait faire, lui qui rêvait depuis toujours de voir le monde. Ce que je devais comprendre, c’était qu’on se reverrait, au plus tard dans quelques années, que le temps filait vite et qu’il m’écrirait souvent.
J’ai dit « d’accord », je n’avais pas le choix. On a profité des derniers jours pour parcourir la forêt dans tous les sens, boussole en main, comme si on n’avait pas connu par cœur le moindre de ces chemins, on a photographié chaque sentier, il voulait emporter ses racines d’explorateur avec lui. Un après-midi particulièrement chaud, la veille de son départ, on s’est allongés au bord de la rivière. Il s’est endormi, la boussole dépassait de sa poche. Je ne sais pas ce qui m’a pris, tout à coup je l’avais dans la main et je suis parti faire un petit tour en solitaire.
Jamais je n’avais joué ainsi les explorateurs tout seul, je me racontais mon histoire en marchant, jetant un œil à l’instrument de temps en temps comme si je m’étais trouvé dans la jungle. Quand je ne la regardais pas, elle était dans ma poche, bien au fond, en sécurité. J’aimais la sentir là, un peu à moi, pour une fois. Quand je suis revenu auprès de mon frère, il dormait toujours, j’allais pouvoir garder ma petite escapade secrète. J’ai glissé la main dans ma poche, elle était vide.
Affolé, je suis revenu sur mes pas, j’ai cherché un peu partout, n’importe comment, et bien sûr je n’ai rien trouvé. À son réveil, mon frère m’a fait un grand sourire, a déclaré « mon vieux, je meurs de faim, on rentre », et je suis resté muet. Muet aussi plus tard, pendant les recherches frénétiques dans toute la maison, sur tous les chemins qu’on avait parcourus dans la journée. Plus l’heure avançait, plus je me sentais coupable et pourtant, tout au fond de moi, une méchante petite voix disait « qu’est-ce que ça peut bien faire, il s’en achètera une autre, pourquoi en aurait-il besoin puisqu’il ne viendra plus se promener ici, avec toi ».
Quand la guerre a de nouveau éclaté, il était au Brésil. Les années ont passé, la paix est revenue, je me suis marié, j’ai eu des enfants, mon frère nous a rendu visite, toujours l’été, on allait arpenter la forêt. Chaque fois je pensais, « cette fois-ci, je lui raconte, après tout, il y a prescription », et chaque fois le temps me manquait, le cœur, plutôt. Et puis, un jour, il a été trop tard.
Encore une fois, il était parti à l’autre bout de la planète pour un chantier gigantesque, enthousiaste comme à ses débuts. Il m’avait écrit, émerveillé, que les travaux de déblaiement avaient mis au jour les restes d’une ville vieille de peut-être 2 000 ans, ses patrons étaient furieux du retard imposé par les archéologues, mais lui était sur un nuage, il promettait de tout me raconter. La lettre suivante était signée d’un de ses collègues et m’annonçait sans ménagements qu’un grave accident s’était produit sur le chantier de fouilles et que malheureusement, il était au regret, etc.
J’ai pensé « heureusement, les parents ne sont plus là », puis je suis parti, sans réfléchir, marcher dans cette forêt que nous connaissions si bien, lui et moi. C’était la fin de l’été, je suis allé jusqu’à la rivière, j’ai enlevé mes chaussures pour marcher dans l’eau glacée, comme autrefois, guettant le reflet d’un poisson, le chant d’un oiseau, revivant nos voyages et nos rêves. Elle était là, mon vieux, intacte, scintillant au bord de l’eau entre deux galets. La boussole.
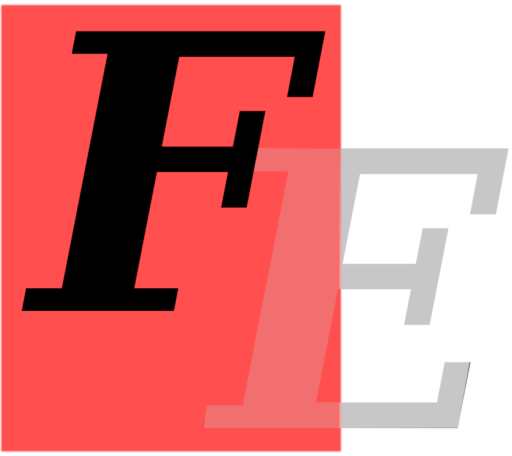

Laisser un commentaire