L’image d’illustration est signée Yluap, dont vous pouvez – non, dont vous devez ! – aller admirer le travail dans la partie Studio de Feuilles d’Encre.
Madeleine
J’ai dû attendre d’avoir l’âge – avec quelle naïve impatience ! –, mais dès le début de la guerre j’ai voulu participer, être auprès des blessés, prendre ma part, en somme, puisque je ne pouvais pas me battre. Des blessés sûrement magnifiques, souriant malgré la douleur de plaies et bosses qui laissaient de jolies cicatrices… Les journaux l’affirmaient : quand par hasard les piètres balles allemandes atteignaient leur but, c’est tout juste si elles parvenaient à traverser nos uniformes. Pour un peu, les hôpitaux auraient davantage eu besoin de couturières pour rapiécer vestes et pantalons que de chirurgiens pour amputer et d’infirmières pour panser. Point de cercueils dans mes rêves.
Comme toutes mes amies, je n’y voyais qu’une aventure, l’occasion de retarder le mariage et la vie rangée qui nous attendaient ; élevées pour devenir de respectables épouses et mères, le monde réel nous était étranger. Et puisque nous allions gagner en un rien de temps ! Qu’aurions-nous pu savoir des champs de bataille, des corps abîmés, de la douleur et de la mort ? Les mois passaient, mais on continuait d’y croire, à l’arrière : tout cela prenait du temps parce qu’il en fallait pour arriver jusqu’à Berlin, voilà tout. Rien n’aurait pu nous préparer à ces années d’apocalypse.
La tête pleine de mauvais romans, je me voyais entrer dans une salle peuplée de beaux jeunes gens à peine meurtris, toujours prêts à plaisanter en attendant la victoire imminente, flirtant un peu, bien sûr, en toute innocence. Je rêvais surtout d’échapper à ma prévisible existence : orpheline, l’oncle et la tante qui m’avaient recueillie n’étaient pas des Thénardier et je n’étais pas Cosette, mais si je ne voulais pas épouser le premier qui offrirait de m’entretenir à leur place, je devais trouver un travail et la vie d’infirmière me semblait pouvoir combler mon désir d’ailleurs et d’aventures.
Je suis donc arrivée, avec mes consœurs, la fleur au tablier blanc comme nos soldats la fleur au fusil ; et, comme eux, la réalité nous a fauchées net. Dès nos premiers jours près du front, dans le vacarme des canons, nous avons vu affluer les morts. Puis, au fil des mois, pire que les morts, les massacrés aux visages détruits, les gazés suffocants, les infirmes, les déments et partout, dans leur chair et dans leur regard, une indicible souffrance. Même ceux qui étaient légèrement touchés avaient ce regard égaré, cette allure d’enfants perdus dans un monde devenu fou.
Exténués, les infirmières-chefs étaient dures et les médecins nous ignoraient. Les hivers glacials, les étés torrides, la vermine contre laquelle il fallait lutter sans cesse nous épuisaient. Beaucoup n’ont pas tenu le coup. Le sang où que l’on pose les yeux, sur les corps, imbibant les matelas, sur nos mains, dans l’eau des lessives, sur le sol des salles de chirurgie, le rythme effréné des arrivées, la gravité croissante des blessures auraient suffi à en décourager plus d’une. Mais le pire, c’étaient les cris, les pleurs d’enfants de ces soldats dans leur lit, et les nuits de trêve devenaient plus redoutables que les journées passées à courir d’une table d’opération à l’autre en espérant que le prochain obus ne nous tomberait pas sur la tête.
J’ai serré les dents et j’ai tenu bon, d’abord parce que je ne voulais pas rentrer chez moi pour m’entendre dire qu’on m’avait prévenue, que la guerre n’était pas une affaire de gamines ; mais, surtout, parce que je ne pouvais pas abandonner ces hommes terrifiés. J’ai appris à ignorer l’odeur du sang et de la gangrène et à me taire ; j’ai commencé à tenir un journal de bord.
Cela peut paraître étrange, mais ce journal me permettait vraiment de garder à distance le trop-plein d’émotions, de transformer la violence en mots. Comme je profitais de chaque minute libre pour remplir mes cahiers ou écrire des lettres, on m’a surnommée la Plume, autant pour ma passion que pour mon format de moineau.
Parmi tous les blessés, beaucoup ne savaient pas quoi dire à leur famille ni, surtout, comment le dire. Bien sûr, il y avait ces cartes postales toutes prêtes – si petites qu’on ne pouvait guère y écrire autre chose que « je suis vivant » –, bien pratiques pour l’armée qui surveillait de près le courrier. Les amoureux, les pères inquiets avaient le droit, naturellement, d’écrire de vraies lettres, encore fallait-il savoir comment et, tout simplement, pouvoir le faire… Ceux qui avaient les mots, mais ne pouvaient tenir un crayon et tous ceux qui n’avaient jamais appris à exprimer leurs sentiments avaient besoin d’aide. C’est ainsi que j’ai commencé mon travail d’écrivain public.
Ma première missive n’a pourtant pas été pour un combattant, mais pour un jeune médecin. Venu pour soigner, il avait en quelques semaines constaté son impuissance : en fait de réparer, il ne faisait que rafistoler et amputer. Puis était arrivé le plus dur : renvoyer sur le front les chanceux qui avaient guéri pour les retrouver fracassés… Il ne savait plus quoi écrire à ses parents pour les rassurer sans leur mentir.
Et il fallait encore composer avec la censure, qui s’efforçait d’empêcher la réalité d’atteindre l’arrière. Alors, j’inventais. J’étais leur confidente à tous, qu’ils aient 20 ou 40 ans et, à partir de ce qu’ils me racontaient de leur vie d’avant et de leurs espoirs pour après, je brodais un semblant de bonheur. Je n’étais qu’infirmière, mais je les aidais à survivre, moi aussi.
C’est mon premier « patient », le jeune docteur V…, qui a encouragé les soldats à me solliciter, obtenant même de l’infirmière-chef, non sans mal, qu’elle me laisse organiser mon « service courrier » comme je l’entendais. Dès lors, je passai mes journées à soigner et une partie de mes nuits à écrire.
Je ne sais pas combien de ces lettres ont pu réconforter leurs destinataires : au bout de longs mois de guerre, qui pouvait encore s’y laisser prendre ? D’autant qu’à l’arrière, on voyait bien revenir les infirmes qui ne voulaient rien raconter et les permissionnaires qu’il fallait soûler pour les remettre dans le train. Mais chaque passage du facteur apportait au moins la preuve que les absents étaient toujours vivants, blessés peut-être, différents sans doute, mais vivants.
Environ un an avant la fin de la guerre, j’ai quitté le front pour un hôpital en repli, un service à la fois moins épuisant et plus terrible. Certains y finissaient de se rétablir en priant pour ne pas retourner en enfer et d’autres demandaient dans leur délire de fièvre et de désespoir qu’on les achève. Les premiers pouvaient envisager de reprendre le cours de leur existence, même s’ils ne se rendaient pas encore bien compte qu’il ne suffirait pas de rentrer chez eux pour être vraiment de retour. Les seconds, infirmes ou défigurés, se sentaient comme déjà morts et pourtant condamnés à vivre.
C’est dans cette espèce de purgatoire que j’ai rencontré Anatole et Victor et entendu parler de Nardeillac pour la première fois. Aucun d’eux n’avait eu recours à mes services épistolaires, mais je les avais soignés longtemps et jamais je n’aurais pu oublier Victor, dont le village avait été détruit dès les premières semaines de la guerre, ni Anatole, qui écrivait sans cesse à sa femme pour lui raconter sa découverte d’un oiseau des tranchées, miraculeuse créature à laquelle j’avais choisi de croire, suivant jour après jour avec son auteur la naissance encyclopédique de ce petit volatile coloré :
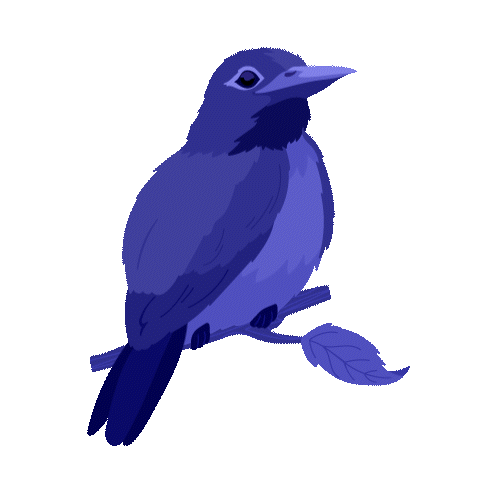
Stridula volansis : petit oiseau bleuté des Ardennes, peut-être de la famille des colibris, identifié par Anatole Marzelle, instituteur de village, lors de son seul voyage hors de sa campagne natale.
Et puis la guerre a pris fin. Anatole est rentré auprès des siens ; peu après, Victor est parti à son tour. Je crois qu’il espérait retourner chez lui ; il avait pourtant assez combattu dans la région pour avoir perdu toute illusion. Sans doute avait-il besoin de voir de ses propres yeux qu’il ne restait rien du monde d’avant, comme il ne restait rien de nous, au fond. Quant à moi, j’ai tenu jusqu’au départ du dernier blessé, du dernier cercueil.
Je ne savais pas alors que je ne rentrerais pas chez moi, que je continuerais de soigner et d’écrire et qu’un village où je ne connaissais qu’un instituteur un peu fou qui dessinait des oiseaux deviendrait mon petit pays.
***
Lucie
Après cinq ans de guerre, la rentrée s’est faite dans les deux écoles, Anatole a retrouvé ses garçons et moi mes filles ; nous avons décidé, sans même nous consulter, de les laisser ensemble dans la cour pour les récréations, les habitudes sont prises… Je tends l’oreille dès que mes élèves sont silencieuses, penchées sur leurs cahiers et je ressens chaque fois un soulagement ; il est bien là, gronde à peine, lit la leçon, chante ou fait rire les enfants, comme avant, mais il n’élève plus jamais la voix. Pourtant j’ai eu peur, quand il est rentré ; c’était bien lui, mais comme absent de lui-même, comme si son corps était revenu sans son âme. Et puis, peu à peu, il a repris vie.
Dans la guerre, dans la paix retrouvée, les petits imitent les grands : les garçons courent et crient, beaucoup, se tapent dessus, un peu, boitillent, jouent les aveugles, grimacent et s’entortillent le crâne dans un chiffon ; les filles arrangent un foulard sur leur tête à la manière des infirmières et affichent des airs de martyres. D’où leur viennent ces idées, dans un village où l’on n’a vu revenir ni blessés ni cercueils ? Il faut croire que la rumeur et les journaux ont trouvé leur chemin jusqu’à nous et lentement distillé leurs sombres images dans les jeux des enfants.
Curieusement, alors qu’aucun homme n’est rentré à part Anatole, les gamins ne jouent ni à la mort, ni aux enterrements, ni aux familles endeuillées. Aucune cérémonie dans leurs saynètes, rien de figé, ils sont dans l’action, ils souffrent, soignent, consolent. Sans doute n’ont-ils pas perdu tout espoir, eux, au contraire des adultes qui s’attendent toujours au pire : si aucun père, frère ou oncle n’est ici, c’est sûrement qu’ils sont vivants quelque part, puisque leur maître est bien là, lui, en chair et en os. C’est ainsi que la nouvelle génération persiste à espérer, malgré les blessures, le chagrin et la douleur.
J’étais tellement heureuse de l’avoir retrouvé entier que j’ai mis plusieurs semaines à mesurer combien Anatole avait changé, au fond de lui. Les premiers temps, nous étions si émus, tous les deux, que nous n’avons presque pas parlé. Le simple bonheur de nous toucher, de nous tenir par la main, de dormir l’un près de l’autre nous suffisait – et seulement dormir, il ne voulait pas que je sente sa maigreur, que je voie les traces des piqûres de puces, les cicatrices et toutes les marques que la guerre avait imprimées sur son corps. La vie a repris, comme avant et différente à la fois. Quand il me regarde, je sais qu’il m’aime toujours, qu’il est l’homme que je connais depuis si longtemps, même si je vois bien que son esprit repart là-bas, de temps en temps, là où je ne peux pas le suivre.
Cela m’est égal, Anatole est rentré ; cela m’est égal qu’il soit dans ses pensées, tant qu’il me sourit quand nos yeux se croisent ; cela m’est égal qu’il me réveille la nuit parce qu’il pleure et parfois hurle dans son sommeil, je le berce jusqu’à ce qu’il s’apaise ; tout m’est égal, car je sais que derrière ces yeux perdus dans le lointain, il est là, avec sa douceur et son amour pour moi. Je suis patiente, nous avons le temps et la jeunesse pour nous.
Et puis, il y a l’oiseau. Ce Stridula volansis, qu’il dessine encore et encore, sur lequel il écrit sans relâche et que les enfants ont adopté au point de le faire apparaître partout, griffonné sur les cahiers de brouillon ou avec un morceau de craie dans la cour, bricolé avec trois bouts de ficelle, jusqu’à mes filles qui en brodent en cours de travaux ménagers… Un élève lui a même demandé comment fabriquer un petit automate – Anatole a toujours été passionné par les automates et les boîtes à musique.
L’hiver vient, la neige, Noël sera tout aussi étrange que d’habitude, mais au moins, la chorale de l’école sera au complet, avec institutrice et instituteur, on pourra rêver au retour des soldats – n’est-ce pas la période des miracles ? Et on mérite bien un miracle, au village, après tous ces sacrifices pour une guerre à laquelle on n’a pas compris grand-chose, à part qu’on n’avait pas le choix. J’entends les enfants répéter les conversations de leurs mères : il paraît qu’un train de prisonniers arrivera en ville la veille de Noël, non, c’est un hôpital qui renvoie – il était temps ! – les derniers blessés, mais non, voyons, c’est cette démobilisation qui n’en finit pas, et les routes et les voies ferrées en mauvais état retardent les convois, sans parler du courrier qui marche mal et du gouvernement, là-haut, qui s’en fiche bien, allez…
Eh bien, il a eu lieu, ce miracle ; enfin, un petit miracle, il ne faut pas trop en demander au Bon Dieu, même à Noël. Quelqu’un est bien rentré chez nous, au lieu de rentrer chez lui, là-bas dans le nord, où il ne reste rien de son village ni de sa vie. Et quand je dis rentré chez nous, je n’exagère pas : ce n’est pas le hasard qui nous l’a amené, Victor, pas seulement la solitude, c’est ce Stridula dont Anatole lui a tant rebattu les oreilles. Ce tout petit oiseau dont il s’est souvenu en entendant quelqu’un parler de notre village de disparus. Ceux qui étaient revenus, entiers ou en morceaux, ceux qui ne reviendraient pas et ceux qui les attendraient, encore un peu ou toujours : c’était l’essentiel des conversations, dans les gares.
Il y avait un train qui venait par chez nous : Victor a décidé d’être de ceux qui reviennent.

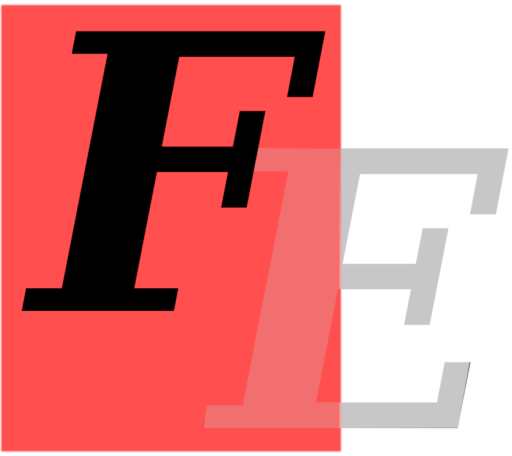

Laisser un commentaire