Il fait gris sur le Jardin des plantes, ce qui ne décourage ni les familles en rituelle balade dominicale, ni les petits qui piaillent sur le manège, ni les promeneurs. Sur les bancs, dans l’allée, certains ont une valise à leurs pieds, on est en face de la gare.
La scène ressemble à un théâtre. Dans le décor, au fond, le manège diffuse un étonnant mélange de musique de boîte de nuit ringarde et de classiques de la chanson française à l’accordéon, les enfants crient d’excitation en essayant d’attraper la queue du singe en peluche qui leur échappe à chaque fois. Autour, des gens marchent, indifférents au monde, en regardant leur téléphone.
Le personnage principal, c’est elle, grande, mince, souriante et triste à la fois. Elle est assise, mais ne tient pas en place, en grande conversation avec deux jeunes filles. Toutes les trois n’ont pas l’air de se connaître, pourtant, et les adolescentes finissent par se sauver, riant toutes les deux. De cette femme ?
Elle reste seule, continuant à sourire pour elle-même, se lève. Ses longues jambes vacillent sur des bottines en daim à très hauts talons, elle se retient d’une main au dossier du banc où elle a installé ses affaires. Elle est jeune et épuisée, son visage fin n’est pas maquillé et elle a sur le front une bosse qui saigne encore un peu – une chute ? Un coup ?
Sortant une paire de baskets d’un sac en plastique, elle s’assied et médite une minute sur l’opportunité de les mettre, peut-être parce qu’elles iraient bien avec son long caleçon gris qui évoque un survêtement, peut-être parce qu’elles seraient plus stables que ses élégantes chaussures de ville. Elle enlève bottines et chaussettes, les observe un instant, se ravise et range soigneusement les baskets avant de se rechausser. Ses mouvements ont la dignité et la lenteur de l’ivresse consciente d’elle-même et qui veut se maîtriser à tout prix.
Toute sa vie tient dans une grande valise mauve, un cabas de supermarché et un sac à main noir aux grosses boucles dorées, qu’elle ne cesse de vider et de ranger. Elle secoue et plie des vêtements, vérifie ses papiers, empile sur le banc des livres et des cahiers d’écolier qu’elle feuillette d’abord, émue, s’arrêtant sur certaines pages, les caressant presque. De la valise tombe un de ces calendriers personnalisés avec des photos de famille : une petite fille à couettes vêtue d’une robe à frous-frous y sourit, fière du trou laissé par deux incisives tout juste tombées. La jeune femme se précipite sur le calendrier, l’essuie avec un soin angoissé, vérifie qu’il est intact avant de l’embrasser avec douceur.
J’ai rarement vu quelqu’un d’aussi concentré, précis dans ses gestes, malgré son regard qui se voile par instants, perdu dans la brume de ses pensées. Elle reste pourtant attentive à ce qui se passe autour d’elle, comme en alerte, souriant aux enfants, ignorant les adultes qui, de toute façon, détournent le regard quand ils risquent de croiser le sien.
Une grand-mère approche avec une fillette d’environ cinq ans et des jumeaux encore en poussette. Elle détache les petits et, n’arrivant pas à enclencher le frein, cale le lourd engin contre un banc avant d’installer les enfants impatients sur le manège. Lentement, la poussette glisse le long du banc et se met à rouler. En une seconde, la jeune femme la rattrape, la ramène près du banc, bloque le frein et va prévenir la dame, échange quelques phrases avec elle, aussi à l’aise que dans un salon mondain.
Elle retourne vers son banc, tout son corps est tendu dans l’effort de marcher droit. Elle s’assied et continue son inventaire ; le calendrier rangé bien à plat parmi les vêtements dans la valise, elle remet les livres dans le cabas et vérifie une dernière fois son sac à main, toujours concentrée, toujours indifférente aux passants. Puis, apparemment prête – mais à quoi ? –, elle croise les jambes et attend.
Je ne saurai jamais ce qu’elle attend, car mon train part dans dix minutes. Je suis là par hasard, parce que je préfère un banc au Jardin des plantes, même sous la bruine, au grand hall de la gare de Nantes. Mais il faut vraiment que j’y aille, maintenant, pourquoi prendre le risque de rater mon train ? Pourtant, j’ai l’impression d’abandonner cette femme, l’impression que je devrais savoir ce qui lui arrive avant de la laisser à elle-même, l’aider, peut-être, mais comment ? Tant d’histoires sont possibles.
A-t-elle fui un mari brutal ou, au contraire, un homme qu’elle aimait l’a-t-il abandonnée ? Lui a-t-on retiré la petite fille du calendrier parce qu’elle se saoule au lieu de s’en occuper ? A-t-elle perdu travail et domicile ou tout laissé derrière elle ?
La tristesse sur ce visage gracieux est peut-être celle du deuil, le deuil d’un homme, de cette fillette, disparus dans un accident, qui sait. Ou du deuil de cette enfant — accident, maladie —, douleur saccageant au passage les deux parents, projetés loin l’un de l’autre par le chagrin. Ce ne sont pas les raisons de se laisser sombrer qui manquent, dans la vie.
Ou alors cette femme, sous ses dehors de mater dolorosa, est une mère abusive, une épouse tyrannique, une manipulatrice perverse. Elle peut, malgré ce visage angélique ou grâce à lui, avoir humilié son mari jusqu’à ce qu’il se pende ou se réfugie à l’autre bout du monde avec l’enfant. Il est possible également, on voit tant de choses, que cette petite fille regardée aujourd’hui avec adoration soit à l’hôpital à cause d’elle, blessée, traumatisée ou, grande à présent, vive loin d’elle et ne veuille plus jamais la voir. Allez savoir.
Elle pourrait aussi être simplement atteinte d’une folie douce, vivre dans un monde imaginaire, solitaire, souriant à ceux des passants qui la regardent gentiment sans prêter attention aux autres, un œil de grande sœur attentive sur les petits qui descendent du manège et cavalent vers d’autres jeux, marchant dans la vie avec, dans son sac, les souvenirs d’une enfance jamais refermée.
Je dois vraiment partir, maintenant, le train ne m’attendra pas. Que pourrais-je lui dire ? Que pourrais-je faire pour elle, que je ne connais pas et qui n’aurait peut-être que faire de ma compassion ? Le TGV part dans quelques minutes, j’attrape ma valise et je traverse la rue en courant. Je la laisse là, avec son demi-sourire, sa valise et ses sacs, ses chaussures trop habillées, son ivresse et sa solitude. Et je sais que je continuerai de penser à elle, de moins en moins souvent, mais très longtemps. À son mystère et à mes regrets inutiles.
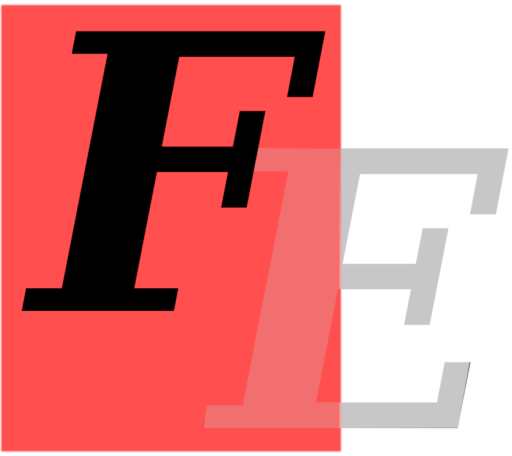

Laisser un commentaire