Ma douce,
Tout est gris ici, gris et brun sale, il y a longtemps que la moindre fleur, le moindre brin d’herbe ont disparu. Des arbres morts il ne reste que le squelette, qui semble mourir encore et encore chaque fois qu’un éclat d’obus ou une balle en arrache une dernière branche, un dernier morceau d’écorce. Sur le calendrier le printemps est là, mais rien ne poussera plus ici, jamais, saison après saison, année après année, cette terre restera un gigantesque cimetière sans une fleur. C’est ce qui me fait le plus de peine, tous ces morts sans une fleur, sans une pierre portant leur nom, comme des restes jetés aux rats.
J’essaie d’y croire, de croire à mon retour auprès de toi, mais pourquoi survivrais-je ? Pourquoi moi, alors que tous ceux qui m’entouraient y sont restés ou pire, en sont revenus des moitiés d’hommes ? Alors je pense à toi, ma douce, je me perds dans le souvenir de ta peau, de ton parfum, dans la couleur de tes yeux et la douceur de tes cheveux. Je pense au jardin, aux fleurs qui s’y étalent avec indolence au moment même où je t’écris, perdu dans la boue stérile de ces champs autrefois si féconds.
J’ai peur de devenir fou, je cherche à maîtriser mon esprit en m’empêchant de penser à ce qui m’entoure. Mais le bruit, le sang, la saleté, la fatigue et la faim ne me laissent pas de repos. Je ne peux pas te dire tout ce qui se passe ici, je ne veux pas que tu voies ce que je vois, je sais que tu dois y penser sans cesse, c’est bien assez.
Avec tout mon amour,
Ton pauvre homme.
(Cette lettre est restée dans la poche du soldat Marzelle, autant pour éviter une censure certaine que pour ne pas faire pleurer sa Lucie.)
*****
Ma douce Lucie,
Le printemps est finalement arrivé dans mon trou à rats, malgré le feu et la boue ! Un oiseau s’est posé devant moi ce matin. Un oiseau, vivant ! Vivant, voletant, pépiant, même. Je le soupçonne d’être d’une espèce tout à fait nouvelle : invulnérable, insensible aux balles, aux gaz et aux obus, aveugle à la laideur de ce champ de bataille, sourde aussi aux hurlements des blessés.
Je croirais volontiers à un miracle, si je croyais encore en Dieu. Mais comment croire, ici ? Comment croire que l’humanité n’a pas décidé de mourir, d’un seul coup, en abattant en une seule guerre des générations entières ? Même l’aumônier n’essaie plus de nous convaincre que tout cela a encore un sens.
Allons bon, moi qui voulais te distraire avec mon improbable moineau – quoique, à la réflexion, il ressemble plutôt à un colibri, ce qui est encore plus incroyable –, voilà que je vais te faire pleurer. Ne m’écoute pas, ma douce, écoute le chant des oiseaux et respire les fleurs pour moi, ce soir.
Ton Anatole
(Contre toute attente, cette lettre-là est arrivée jusqu’à sa destinataire.)
*****
Ma Lucie,
L’oiseau est revenu. Ce n’est ni un moineau ni une mésange, ni rien que je connaisse, je crois vraiment que c’est une nouvelle espèce, née ici, un événement absurde et merveilleux dans un temps absurde et tragique.
Sous son plumage rouille, couleur passe-partout, il y a comme des reflets d’arc-en-ciel et il siffle sur huit notes, toujours les mêmes, huit notes claires, incongrues ici. Ce matin il s’est posé tout près de moi et je l’ai baptisé Stridula volansis, ce qui ne veut rien dire, mais lui va bien, avec un petit côté savant. Imagine-toi un peu, dans quelques années, une nouvelle entrée dans les dictionnaires :
Stridula volansis : petit oiseau des Ardennes, peut-être de la famille des colibris, découvert par Anatole Marzelle, instituteur de village, lors de son seul voyage hors de sa campagne natale.

J’ai l’impression que je suis le seul à le voir ; pour tout dire, je ne suis pas mécontent de le garder pour moi, ce petit Stridula volansis, pour les rares instants de calme, égoïstement. Et puis, je n’y crois pas tout à fait, c’est tellement extraordinaire, un oiseau vivant, ici !
Je l’ai peut-être inventé, rêvé, peut-être est-ce mon cerveau qui se protège de la souffrance, de la peur et de la laideur avec ce tout petit piaf de rien du tout. J’ai vu assez de camarades devenir fous, si c’est ma folie à moi, je la bénis, elle me permet de continuer à voir le monde en couleurs.
À toi.
*****
Lucie,
Pardon, ma douce, d’avoir parlé de folie dans ma dernière lettre. Ne t’inquiète pas, je suis bien décidé à garder ma raison, mes deux jambes et le reste. Puisqu’il semble que nos chefs ont décidé de nous oublier ici jusqu’à Dieu sait quand, j’occupe mon temps, entre deux assauts, à l’étude de Stridula volansis. Je l’observe, je le décris, je le dessine.
Qu’il y ait un Dieu ou plusieurs, ou aucun, je suis sûr d’une chose : je ne peux pas mourir avant d’avoir terminé une contribution aussi importante à l’ornithologie moderne – fût-elle imaginaire ! Je ne peux pas non plus perdre la vue, ni mes mains pour écrire et dessiner, ni mes jambes pour suivre ces plumes qui sautillent dans ma tranchée.
Tu vois, il est impossible à présent qu’il m’arrive quelque chose, dût cette guerre durer encore des mois ou des années. C’est peut-être bien un miracle, le miracle qui me fera rentrer sur mes deux pieds et la tête sur les épaules.
Ton Anatole
*****
Anatole, mon amour,
Tes dernières lettres sont toutes arrivées en même temps, j’ai donc vécu en une fois l’aventure de ta découverte ornithologique, la plus grande de ce temps, assurément ! Sache que je la prends très au sérieux, cette preuve que la vie trouve toujours son chemin, malgré tous les obstacles qu’on lui oppose.
Stridula volansis, quel joli nom, il me semble l’entendre pépier. Envoie-moi s’il te plaît tes dessins et tes observations, je les montrerai à nos élèves, je leur parlerai de toi et de cet oiseau, qu’ils sachent que même dans les combats tu restes le maître d’école un peu fou qui remarque toujours ce que les autres sont incapables de voir.
Tu leur manques, à tes garçons ; ils sont gentils avec moi, car nous partageons la douleur et l’inquiétude de l’absence : ils n’ont souvent plus ni père, ni frères, ni oncles, ni cousins. Ils jouent à la guerre, pour croire encore à la gloire.
Les filles font comme leurs mères, elles serrent les dents et patientent, elles ont appris la résignation, ce sont déjà de petites veuves de guerre.
Mais tous, à mesure qu’arrivent les noirs télégrammes et que reviennent les estropiés, ont le sourire plus rare… Ton oiseau les fera rêver, un moment au moins.
Moi, je t’attends.
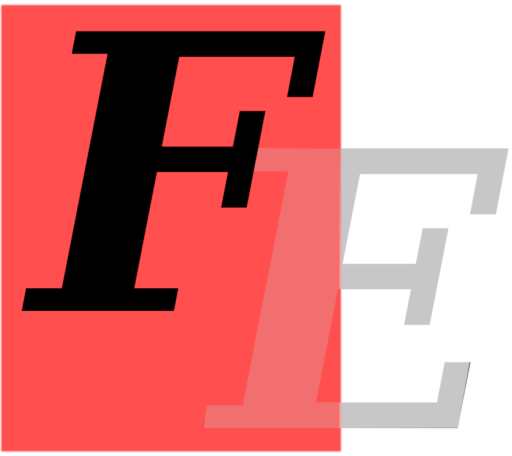

La suite ?
On y travaille 🙂
Chère Anna, n’y travaillez tout de même pas « d’arrache pied »… revenez nous entière avec la suite de ce très joli texte. Bien à vous. Romuald