Un mur de verre se dresse entre un homme exaspéré et une employée indifférente. Ou peut-être seulement impuissante, elle aussi, devant l’arbitraire administratif. Lui ne comprend pas pourquoi il doit retourner au service des admissions avant de pouvoir enregistrer sa femme à la caisse des consultations, ou l’inverse, allez savoir, alors qu’elle est soignée dans le même service depuis des semaines, il le sait bien, c’est lui qui l’amène à chaque fois, jamais il ne la laisserait seule dans un endroit pareil, c’est quand même un monde un bazar pareil ! L’employée ne sait pas non plus pourquoi le parcours du patient au médecin ressemble à un labyrinthe et de toute façon, cela ne l’intéresse pas vraiment. Assise toute la journée derrière son bureau, elle tamponne des dossiers et ne saura jamais – elle préfère, d’ailleurs, car même si elle le savait, que pourrait-elle y faire ? – qui sont tous ces gens, de quoi ils souffrent, s’ils ont peur. Son rôle se borne à vérifier que ces patients sont bien qui ils prétendent être, sont bien à l’heure et au bon endroit, et que leur facture pourra être présentée à la Sécurité sociale et aux mutuelles.
Cet homme qui est là, à tempêter contre la bureaucratie et les fonctionnaires, accompagne donc sa femme qui vient suivre un traitement. Il répète « Mais bon Dieu de bon Dieu, c’est quand même pas croyable toute cette paperasse à chaque fois, elle vient pour son traitement ! » Il se retourne, inquiet, vers la malade assise un peu plus loin. Sa peau est presque transparente, elle a l’air de se désintéresser totalement de son propre sort ; elle regarde gentiment son mari qui s’agite, elle le laisse faire. Pendant qu’il s’époumone ainsi, il a l’impression de faire quelque chose pour elle, de lutter, de pouvoir changer le cours des événements. Enfin, la situation se dénoue : le bruit a fait sortir une autre employée de son bureau, elle est venue donner un dernier coup de tampon et le feu vert pour monter voir le docteur. Elle se donne même la peine de venir du côté réservé au public pour remettre son sésame à la patiente, et expliquer au mari comment s’y prendre la prochaine fois. L’homme la remercie, se penche vers sa femme, l’embrasse et arrange le châle autour de ses épaules. Puis il l’aide à se lever et la soutient avec une infinie délicatesse jusqu’aux ascenseurs, non sans s’être retourné une dernière fois vers la première employée pour la foudroyer du regard. Mais celle-ci, derrière sa vitre, est déjà passée au dossier suivant.
En face de l’accueil, il y a une cafétéria. On peut y manger un morceau, y boire un café, et les étourdis peuvent y acheter un cadeau de dernière minute pour leur vieille grand-mère ou un nouveau-né – beaucoup plus de choix pour les nouveau-nés. Il y a souvent du monde dans la boutique et dans la petite salle qui tente d’imiter une terrasse estivale avec parasols, mobilier en plastique multicolore, posters ensoleillés de plages lointaines et même un faux palmier près de l’entrée. Les malades viennent chercher l’illusion d’une vie sociale, les visiteurs se donnent du courage ou reprennent des forces et le personnel soignant y prend sa pause. La jeune fille qui tient la boutique a de longs cheveux blonds qui encadrent un visage fin aux yeux verts, sur lequel flotte un éternel demi-sourire. Elle a l’air de ne pas être tout à fait là, et naturellement on l’appelle Mona Lisa. Les patients qui peuvent se déplacer trouvent dix bonnes raisons quotidiennes de passer la voir. La consommation de café du personnel, des brancardiers aux internes et des infirmières aux médecins chevronnés est en constante progression, d’autant que les femmes aussi l’aiment bien, cette apparition aux yeux verts. Une petite fille en visite est venue boire un jus de fruits ; elle la regarde, fascinée, convaincue à présent de l’existence des fées.
Au bout du couloir, au secrétariat, une femme élégante, la cinquantaine, surveille avec une impatience polie, mais non dissimulée l’écran suspendu au plafond qui doit lui indiquer son tour. Ses cheveux ont cette blondeur chaude et cette souplesse particulières dues aux coiffeurs des beaux quartiers. Elle n’est ici que pour un examen, si elle devait être hospitalisée il va de soi qu’elle choisirait une meilleure hôtellerie. Quand son tour arrive enfin, il lui manque un papier sans lequel l’hôpital ne peut avancer les frais, il faut qu’elle règle le tout avant son rendez-vous. Elle tend sa carte de crédit, mais le terminal est en panne ; qu’à cela ne tienne, elle sort de son sac un gros portefeuille, dédaigne le stylo bille de l’Assistance publique et paraphe un chèque avec un énorme stylo à plume. La machine le remplit ; royale, la dame ne se donne pas la peine d’en vérifier le montant, qu’elle n’a d’ailleurs pas demandé à connaître.
Dans la salle d’attente patientent déjà avec plus ou moins de bonne humeur une dizaine de personnes. La femme élégante murmure un bonjour, prend un siège dans un coin et se plonge dans un livre. Un infirmier amène une vieille dame dans un fauteuil roulant. Elle porte une chemise de nuit de l’hôpital qui signale d’emblée son état de faiblesse face aux médecins et aux autres patients assis là, habillés et manteau sur le bras, preuve qu’ils peuvent dans l’instant sortir et retrouver le monde, qu’ils ne sont ici que de leur propre volonté. Elle retient un instant l’infirmier et lui demande s’il va la laisser là, toute seule, en chemise de nuit, et combien de temps. Il arrange une couverture sur ses jambes et lui répond gentiment, en parlant lentement et fort, avec une condescendance d’autant plus cruelle qu’elle est inconsciente : il ne fait qu’appliquer ce qu’il a appris en formation, avant son stage chez les vieux, puis il s’en va. Or, sa patiente n’est pas du tout sénile. Elle a le regard vif, ses cheveux très blancs, encore épais et coupés au carré sont bien coiffés. Ses mains sont soignées, elle se tient droite et sourit à l’assistance, cherchant à engager la conversation, à se raccrocher à un statut de malade normal. La dame blonde se plonge plus profondément encore dans son livre, un jeune couple se concentre sur son bébé, un monsieur cravaté écrit frénétiquement SMS sur SMS. Une autre femme âgée, comme un double en vêtements civils de la première, avec sac à main et chapeau, regarde tout à coup au loin ; dans un réflexe, elle a sorti ses clés de voiture de sa poche. La vieille dame ferme un instant les yeux, dans un effort visible pour ne pas pleurer. Elle essaie d’attraper un magazine sur la table basse, pour au moins se donner l’apparence d’une patiente comme les autres, mais elle est trop loin et le brancardier a mis le frein du fauteuil, elle n’arrive pas à le débloquer. Elle sort un mouchoir de sa poche et y cache son désarroi.
Elle ne m’a pas vue, je suis dans un recoin de la pièce, derrière elle. Je ne vaux pas mieux que le reste de l’assistance, j’ai observé toute la scène sans rien dire. Je me fais mon petit scénario : une vieille dame, très digne malgré les circonstances, veuve ou restée demoiselle ? Pas d’enfants, ou trop occupés pour l’accompagner, ou peut-être a-t-elle perdu toute sa famille ? Je me lève et fais quelques pas qui m’amènent dans son champ de vision.
Elle lève la tête vers moi et me sourit. Au moment où je vais faire quelque chose, je ne sais pas quoi, mais quelque chose, l’infirmier revient et lui crie dans l’oreille, en faisant faire un demi-tour à son fauteuil roulant : « Vous voyez, c’était pas bien long ! Allez, maintenant on va faire la p’tite radio, et pis on ira s’reposer, hein ! »
La vieille dame se laisse faire, résignée. Les autres patients se détendent imperceptiblement. Je me sens bête, maintenant, debout sans raison au milieu de la pièce ; heureusement, c’est à mon tour, on m’appelle : « Le médecin va vous recevoir tout de suite, c’est la porte au fond du couloir, vous le réglerez directement, il prend la carte bleue, vous avez bien votre carte Vitale ? »
J’ai toutes mes cartes, oui, et tout d’un coup je me demande ce qui est prévu quand les nouvelles sont mauvaises : on vous annonce la catastrophe, on vous assure que vous serez bien soigné, puis « ça fera tant », et hop, plus qu’à sortir sa carte bleue ? Ou peut-être que dans ce cas c’est gratuit, après tout il faudra bien revenir mourir ici, la facture viendra après, directement envoyée à la Sécu ou aux héritiers. Quelqu’un derrière moi toussote discrètement pour me réveiller, je suis restée plantée là, au milieu de la pièce ; la secrétaire se penche par-dessus son comptoir : « Mademoiselle… le médecin vous attend. »
Je marche dans ce couloir qui me semble s’étendre à l’infini, j’ai très chaud aux joues, mes mains sont glacées. Je n’ai pas du tout envie d’avancer. Peut-être que si je fais demi-tour et que je rentre chez moi, sans rien dire à personne, je pourrai continuer ma vie normalement. Après tout, je me sens très bien et les patients ne manquent pas, je ne risque pas de mettre l’hôpital au chômage. Mais au fond, la porte s’ouvre, le médecin s’avance vers moi, chaleureux, la main tendue, m’appelle par mon nom. Sa technique pour accueillir les mourants, peut-être. Il me sourit gentiment : c’est bon signe ? Je lui serre la main et j’entre m’asseoir.
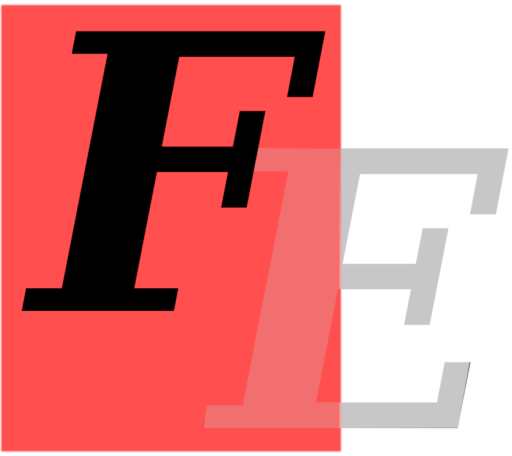

Laisser un commentaire