C’est une idée répandue que si nous sommes amoureux d’une œuvre, son auteur est notre âme sœur. Mais mon auteur préféré, Maurice Valleyras, avait 80 ans et je ne songeais nullement à l’épouser ; j’espérais plutôt avoir la chance de rencontrer, au moins une fois dans ma vie, mon alter ego. J’espérais aussi, je dois l’avouer, que j’aurais alors le courage de lui montrer ce que j’écrivais.
Je travaillais depuis deux ans aux Marronniers, somptueuse demeure perdue dans la campagne où des retraités discrets et fortunés coulaient des jours paisibles. Plus exactement, de futurs héritiers y installaient parents et grands-parents en toute bonne conscience : hôtellerie de luxe, compagnie choisie et plus besoin d’écouter radoter la grand-mère ou le vieil oncle tremblotant dans son fauteuil roulant.
Après des études de littérature et la publication d’une nouvelle dans une revue, la nécessité de payer mes factures et le manque absolu de vocation enseignante m’avait amenée à ce métier un peu particulier, qui n’avait même pas de nom : faire la conversation aux pensionnaires, mettre noir sur blanc leur histoire s’ils en avaient envie et discuter de leur œuvre avec ceux qui écrivaient leurs Mémoires, un roman ou un traité définitif sur un sujet quelconque. J’étais éditrice, bibliothécaire, enquêtrice et biographe, mais surtout j’écoutais.
Au début, je croyais que ces gens riches avaient naturellement eu des vies, sinon passionnantes, au moins si différentes de la mienne que j’allais forcément m’amuser. En réalité, leur existence finissait souvent dans un ennui doré, qu’ils supportaient d’autant plus mal qu’ils avaient joui jusque-là de toute la liberté que l’argent peut accorder.
Je ne nie pas que des conditions luxueuses adoucissent la vieillesse ; néanmoins, quand il faut mourir, le refus et la peur sont les mêmes dans la soie ou dans le caniveau. Le désespoir des millionnaires est peut-être même plus grand, tant ils sont habitués à ce que tout s’achète : la peur de la mort se double de la frustration de se retrouver, finalement, dans la même situation que le premier pauvre venu.
Très moral ? Je n’aurais pas la mesquinerie de jubiler devant un agonisant à l’idée que son compte en banque ne vaut guère plus, à son dernier soupir, que le salaire d’un ouvrier ; et puis, je préférerais que chacun puisse rendre l’âme dans le confort d’une belle chambre, entouré d’amour, en regardant le parc magnifique que j’ai sous les yeux et sans souffrance. C’est mon côté humanisme et lutte sociale — l’idéalisme version Front popu des parents, ça vous marque une enfance, sans parler des années soixante.
Bref, j’avais presque 30 ans et je m’ennuyais. Pourtant ma pensionnaire préférée, Mademoiselle Bianca, faisait de son mieux pour me distraire. Elle y arrivait presque toujours avec ses anecdotes, probablement très enjolivées, sur sa jeunesse délurée dans les Années folles. Mais le printemps cette année-là était exécrable, fait de pluie et de vent et toute la bonne humeur de Bianca n’y pouvait rien.
La nuit tombait dès l’heure du thé, j’avais épuisé les stocks de la bibliothèque et je me morfondais, me lamentant sur mon sort avec une certaine délectation morbide. Un après-midi particulièrement sinistre d’avril, alors que je caressais l’idée de me casser une jambe dans l’escalier, histoire qu’il se passe enfin quelque chose, la directrice illumina ma vie sans le savoir : Maurice Valleyras s’installait aux Marronniers.
Maurice Valleyras, en dehors d’être mon écrivain préféré, était une légende littéraire, auteur d’une dizaine de romans policiers, traduits dans le monde entier, dont le héros était l’assassin. Chacun de ses livres commençait par « Il était une fois, dans la bonne ville de… » et relatait avec élégance et ironie un meurtre parfait : la victime était une ordure et le tueur une sorte de justicier sympathique. Sans cesse à la limite du scandale, voire de la censure, le romancier avait toujours entretenu la discrétion autour de sa vie privée.
J’avais littéralement grandi avec ses livres. La morale de mes parents (qu’ils reposent en paix) tenait en trois mots : tolérance, bienveillance et partage, trois valeurs facilement balayées d’un revers de main par la première brute venue. J’avais vite compris qu’ils ne devaient leur survie dans ce monde qu’à la bonne étoile qui accompagne parfois, mais parfois seulement, les innocents. Désireuse de leur laisser leurs illusions, j’avais donc fait mon éducation dans les livres ; et les romans de Valleyras figuraient au sommet de mon panthéon.
La semaine suivante, sous un soleil de plomb — on était passé de l’hiver à l’été sans transition —, le grand écrivain fit son entrée. D’une simplicité sophistiquée, un léger sourire aux lèvres, il regardait autour de lui avec une curiosité gourmande, comme s’il se délectait à l’avance du spectacle qu’on allait lui offrir. Alors que les nouveaux pensionnaires semblaient généralement méfiants les premiers jours, peinant à croire que c’était pour leur bonheur qu’on les installait ici, cet homme qui avait tout réussi paraissait ravi d’être là.
Sa présence a tout changé : il organisait des lectures dans la bibliothèque, des dîners magnifiques et monta même un petit festival de cinéma auquel assistèrent quelques célébrités. La directrice était aux anges : en un tournemain, il avait séduit la maison entière, du jardinier jusqu’au dernier résident en passant par les infirmières et le cuisinier.
Et moi ? Eh bien, moi, il n’avait pas besoin de me séduire, je lui étais acquise d’avance — littérairement parlant, s’entend. Je profitais de chaque instant en sa compagnie, je l’écoutais faire du charme aux dames, jouer l’amitié virile avec les messieurs ; il semblait apprécier tout le monde et tout le monde, apparemment, l’appréciait. Ce qui ne laissait pas de me surprendre, tant ses romans avaient suscité la controverse en leur temps.
Je sentais aussi qu’il m’observait avec amusement et curiosité. Je ne lui avais rien dit de mon admiration. Nous avons fait connaissance peu à peu, il s’est intéressé à mon travail. Il m’accompagnait dans mes conversations historico-biographiques avec les résidents, mais n’essayait jamais de m’influencer ou d’orienter ma façon de raconter.
En sa présence, et comme malgré eux, les gens parlaient davantage et se laissaient aller à une sincérité que je n’avais pas beaucoup rencontrée jusqu’alors. L’un avait trafiqué le testament de ses parents et ruiné son frère, un autre avait fui après un accident sans s’inquiéter des passagers de la voiture tombée dans le fossé. L’une devait sa carrière à la calomnie et aux intrigues, une autre avait laissé renvoyer à sa place une camarade d’université. Aucun d’eux ne se sentait vraiment coupable : c’était du passé, ils regrettaient — vaguement —, mais sait-on ce qu’on fait, quand on est jeune… Tous minimisaient leurs actes, comme si le simple fait de les avouer, tant d’années plus tard, à un écrivain célèbre leur donnait l’absolution. Les canailles, en somme, étaient bien représentées dans cette société miniature.
Valleyras n’avait rien publié depuis des années ; je lui demandai un jour si les confidences que nous recevions ne lui donnaient pas envie de reprendre la plume, histoire de rétablir un peu de justice au moins sur le papier. Il sourit et me répondit qu’il y avait un âge pour tout : il était à la retraite et n’avait plus ni le temps ni l’énergie nécessaires à la mise en scène d’une belle et parfaite exécution.
Deux ans s’écoulèrent ainsi. Des pensionnaires moururent, des gens bien comme des canailles dignes d’un roman signé Valleyras. Cet homme d’affaires, par exemple, qui avait ruiné plus d’un petit épargnant et s’en était toujours sorti, s’était un soir étouffé alors qu’il dînait pour une fois seul dans sa chambre. Ou cette femme, propriétaire de taudis insalubres qu’elle louait à prix d’or, ce qui lui avait donné les moyens de finir ses jours aux Marronniers : la tête alourdie par une bouteille de champagne, elle s’était noyée dans son bain. Mais aussi ma douce et drôle Mademoiselle Bianca, plongée jusqu’à son dernier souffle dans ses chères Années folles, que l’on enterra dans sa plus belle tenue, fume-cigarette en main et sautoir autour du cou, prête pour un charleston endiablé.
Je continuai mon étrange travail tout en écrivant un roman — dont je m’étais décidée à faire lire les premières pages à mon idole, qui m’avait encouragée à persévérer. Un matin, alors que je voulais justement lui montrer un nouveau chapitre, je trouvai sa chambre vide. La directrice me fit remarquer que sa maison n’était pas une prison, que Monsieur Valleyras était libre de ses mouvements et non, elle n’avait aucune idée de la raison de son départ soudain.
Quelques semaines plus tard, je reçus cette lettre :
Ma chère Adèle,
Il était une fois un roman qui n’en était pas un et un assassin qui ne pouvait plus assassiner. J’ai achevé ma carrière aux Marronniers, mais c’est une tâche sans fin que de nettoyer le monde et je suis fatigué.
Envoyez-moi votre livre quand il sera fini, et rendez-moi visite quelquefois, si le cœur vous en dit. Nous parlerons justice et littérature.
Affectueusement,
M. V.
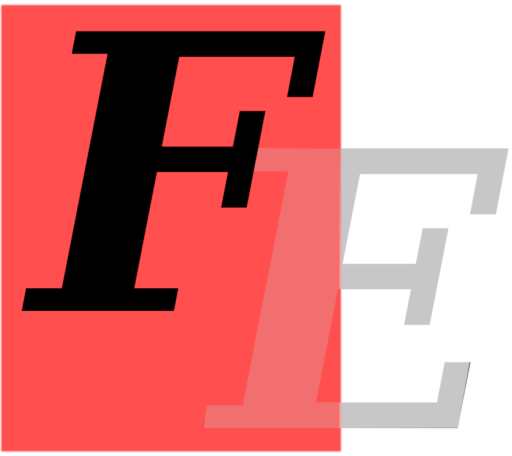

Laisser un commentaire